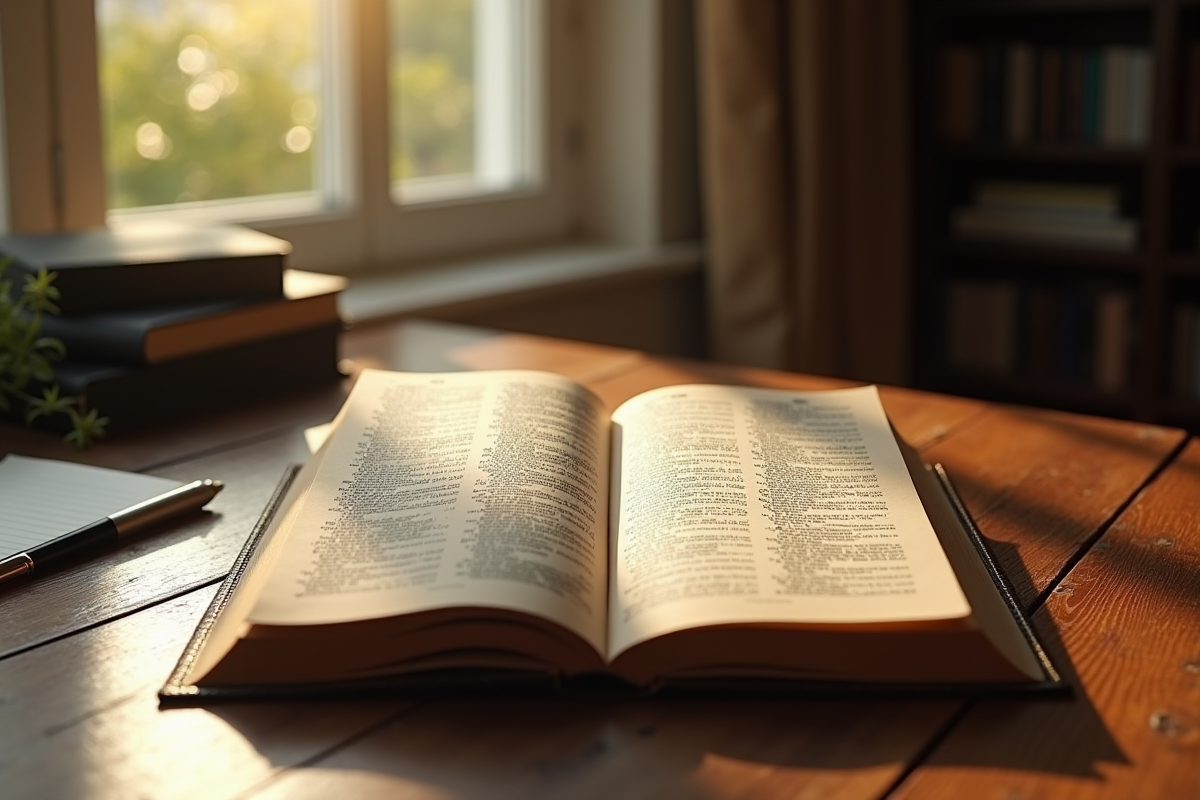Le terme « joli » n’a jamais vraiment trouvé sa place hors du ballet du genre. Sa forme, son usage, trahissent un héritage grammatical pesant, souvent en décalage avec les besoins d’un français plus inclusif. L’absence d’un équivalent strictement neutre, soulignée par les dictionnaires et les recommandations des institutions officielles, installe une zone grise dans laquelle chaque rédacteur, chaque traducteur, doit avancer à tâtons. Un mot qui, malgré sa légèreté apparente, pose une question lourde de sens : comment qualifier sans assigner ?
Pourquoi le terme « joli » interroge sur la neutralité en français
Chaque adjectif, chaque accord, chaque terminaison du français rappelle la prégnance du masculin et du féminin. « Joli », ce mot que l’on croyait passe-partout, met à nu la difficulté d’exprimer le charme ou la beauté sans séparer d’emblée selon le genre. Pour décrire une création, un objet, une personne, il faut choisir la marque grammaticale, comme si la langue même refusait d’accueillir l’ambiguïté.
L’Académie française demeure inébranlable : le masculin prévaut, le neutre est absent. Pourtant, dans de nombreux espaces sociaux et professionnels, le besoin de neutralité s’impose avec force. On en parle lors de colloques, dans les écoles, jusque dans les avis des linguistes : la question grammaticale occupe aujourd’hui une place majeure dans les réflexions sur la représentation de chacun et chacune.
Les usages ne changent pas facilement. « Joli » sonne spontanément au féminin, « beau » s’impose au masculin. Derrière ce qui ressemble à une subtilité de langage, se cache une frontière : elle veut, par des habitudes parfois inconscientes, rendre invisible toute personne ou objet qui ne rentre pas dans la case du genre binaire. C’est l’une des limites tenaces de la grammaire française.
Face à ce constat, plusieurs approches émergent pour élargir le champ :
- adopter des adjectifs épicènes pour contourner les restrictions grammaticales,
- expérimenter la création de nouveaux mots neutres,
- encourager l’évolution des pratiques, démarche empruntée par certains groupes militants et universitaires.
En définitive, « joli » cristallise bien plus qu’une affaire de forme ou de style : il donne à voir les dilemmes de visibilité, d’équité et de mutation linguistique. Tout le débat autour d’une version neutre de « joli » agit comme un révélateur de nos imaginaires partagés.
Quels mots utiliser pour exprimer une appréciation sans connotation de genre ?
Pour qui cherche à exprimer un sentiment positif sans connotation de genre, diverses possibilités prennent place dans un français en mouvement. Voici quelques pistes privilégiées par celles et ceux qui tiennent à la neutralité : les adjectifs épicènes, ces mots qui qualifient le masculin et le féminin sans jamais changer de forme. « Agréable », « superbe », « magnifique », « remarquable » : nul besoin de choisir, le mot reste identique, que l’on parle d’une personne, d’un lieu, d’un événement.
Dans les environnements sensibles à l’inclusion, on entend volontiers « sympa », « extra », « formidable », « parfait ». Ces qualificatifs traversent les échanges du quotidien sans insister sur le genre, manifestant une volonté commune d’élargir le vocabulaire pour inclure tout le monde.
D’aucuns vont plus loin et proposent parfois d’inventer de nouveaux adjectifs, inédits ou inspirés, pensés pour répondre à un monde en quête de repères plus larges. Ce geste reste rare, mais il témoigne d’un réel désir de faire évoluer ensemble le français, pour mieux refléter toutes les identités.
Voici quelques repères concrets pour choisir vos mots sans indiquer de genre :
- adjectif épicène : agréable, superbe, formidable
- langage inclusif : privilégier les termes universels, génériques, qui n’assignent pas
- usage : employer ces adjectifs pour décrire une personne, un objet ou un lieu, sans distinction de genre
En l’absence d’un mot neutre parfaitement équivalent à « joli », ces différentes solutions offrent des alternatives pour contourner la rigidité de la langue, gestes modestes mais symboliques vers une évolution possible.
Panorama des alternatives neutres et nuances possibles selon le contexte
Écrire ou parler de façon inclusive relève parfois du funambulisme. Le français, tout entier pensé autour de la distinction masculin/féminin, ne facilite pas le passage à la neutralité. Pourtant, les efforts se multiplient pour bousculer ce modèle. Le choix du terme dépend de la situation : « agréable », « harmonieux », « attrayant », « plaisant » s’utilisent selon le contexte, chacun apportant sa couleur et son registre.
Décrire une personne invite à la nuance. Parmi les solutions les plus courantes : « charmant », « sympathique », « remarquable », « magnifique ». Des adjectifs épicènes très utilisés dans l’éducation, les milieux culturels ou encore les espaces associatifs, précisément pour éviter de figer le genre et l’attribut.
L’inventivité, parfois, va jusqu’à explorer de nouvelles formes écrites, comme le point médian ou la double flexion : « beau·e », « joli·e ». Ces inventions, même encore rares et parfois contestées, témoignent d’une envie d’imaginer un français plus flexible, avant tout à l’écrit.
| Alternative neutre | Nuance principale | Usage favorisé |
|---|---|---|
| agréable | général, ressenti positif | objet, lieu, personne |
| plaisant | plaisir, convivialité | conversation, situation |
| magnifique | intensité, admiration | description, éloge |
| remarquable | originalité, distinction | travail, attitude |
La logique du français inclusif n’oblige personne, mais incite à explorer de multiples pistes, à inventer de nouveaux usages, pour élargir notre capacité à nommer sans assigner.
Des exemples concrets pour enrichir son vocabulaire au quotidien
Petit à petit, le français évolue et s’enrichit de ces gestes quotidiens qui privilégient la précision autant que l’inclusion. Pour éviter de genrer à tout prix avec « joli », il suffit parfois d’adopter de nouveaux réflexes. Plusieurs adjectifs enrichissent désormais nos échanges, portés par une attention plus soutenue à la pluralité.
- Le mot « agréable » se glisse partout : un lieu, une ambiance, une tenue, une personne, aucun indice sur le genre.
- « Harmonieux » met en valeur la cohérence et la finesse d’un paysage ou d’une création, même si son usage est plus rare à l’oral.
- « Attrayant » ou « plaisant » signalent l’attrait, le charme, la capacité à séduire, que l’on parle d’un projet, d’une idée, d’une réalisation.
L’inclusivité ne s’arrête pas aux adjectifs. Les pronoms neutres font leur apparition, et certains dictionnaires commencent à les mentionner. Cette mutation, soutenue d’abord par des cercles associatifs ou académiques, se diffuse peu à peu dans les pratiques courantes, permettant à chaque individu de trouver sa place en dehors des catégories habituelles.
| Terme | Exemple d’emploi |
|---|---|
| plaisant | Un visage plaisant, une voix plaisante |
| remarquable | Un travail remarquable, une présentation remarquable |
| magnifique | Une idée magnifique, un spectacle magnifique |
Pour de nombreuses personnes non binaires, le souci de neutralité s’exprime par des choix de vocabulaire et des accords soigneusement pensés. Les linguistes engagés dans cette réflexion, comme Eliane Viennot, accompagnent l’évolution du français, pour qu’il puisse accueillir toutes les individualités. Et dans ce cheminement, une chose devient manifeste : la langue française, portée par ses locuteurs et ses locutrices, continue de se réinventer, question après question, mot après mot.